Amnesty International a constaté une très forte augmentation du nombre de personnes exécutées (au moins 1 634) en 2015. C’est le chiffre le plus élevé jamais recensé par l’organisation depuis 1989.
Les États ont eu recours à plusieurs méthodes d’exécution : la décapitation, la pendaison, le peloton et l’injection létale. Ils ont fait montre d’une grande efficacité, le nombre des exécutions ayant augmenté de plus de 50 % par rapport à 2014.
Trois pays seulement sont responsables de près de 90 % des exécutions : l’Arabie saoudite, l’Iran et le Pakistan. Ces chiffres ne tiennent pas compte de la Chine, où les statistiques sur la peine de mort sont toujours secret d’État.
Même si cette recrudescence des exécutions jette une ombre sur 2015, l’année a également été marquée par des lueurs d’espoir. Quatre États ont complètement supprimé la peine de mort de leur législation si bien qu’aujourd’hui plus de la moitié des pays du monde ont tourné le dos à ce châtiment cruel, inhumain et dégradant.
La justice est fondée sur le respect de la dignité humaine […] La sentence capitale n’est acceptable en aucune circonstance.
Tsakhia Elbegdorj, président de la Mongolie, 16 juin 2015


Des exécutions circonscrites dans leur majorité à trois pays
Trois pays seulement ont été responsables de 89 % des exécutions enregistrées en 2015 : l’Arabie saoudite, l’Iran et le Pakistan. Pour la première fois depuis 2008, le Pakistan figurait parmi les cinq pays qui ont exécuté le plus de prisonniers. C’est dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord qu’ont eu lieu la plupart des exécutions recensées, l’Arabie saoudite et l’Iran se taillant la part du lion. Pour la seconde année consécutive, ces deux pays ont procédé au plus grand nombre d’exécutions dans la région.
En Arabie saoudite, les exécutions sont montées en flèche, avec une hausse de 76 % par rapport à l’année précédente ; 158 personnes, peut-être davantage, y ont été mises à mort en 2015. De son côté, l’Iran a exécuté au moins 977 personnes, condamnées essentiellement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L’Iran a continué d’exécuter des mineurs délinquants, c’est-à-dire âgés de moins de 18 ans au moment des faits qui leur étaient reprochés, en violation du droit international. Le pays a également condamné à mort des mineurs délinquants en 2015, tout comme les Maldives et le Pakistan.
Cette année encore, les États ont fait fi d’autres aspects du droit international, condamnant à mort des personnes qui présentaient un handicap mental ou intellectuel, ou qui avaient été inculpées d’infractions n’ayant pas provoqué la mort d’autrui. La peine capitale n’a pas été appliquée que pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, elle l’a aussi été pour adultère, blasphème, corruption, enlèvement et « mise en doute de la politique du dirigeant », entres autres infractions.
Le nombre de pays ayant mis à mort des prisonniers a augmenté – passant de 22 en 2014 à 25 en 2015. Ils sont six au moins à avoir repris les exécutions : le Bangladesh, l’Inde, l’Indonésie, Oman, le Soudan du Sud et le Tchad.
Au moins1 998 nouvelles condamnations à mort ont été recensées en 2015 et 20 292 prisonniers, peut-être davantage, se trouvaient sous le coup d’une sentence capitale à la fin de l’année.
Quelques chiffres sur les exécutions


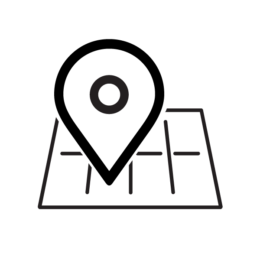

Un nombre d’exécutions plus élevé que jamais au Pakistan
Depuis que le Pakistan a levé son moratoire sur les exécutions de civils en décembre 2014, il a rejoint le club peu enviable des États qui mettent des centaines de personnes à mort chaque année. Il talonne aujourd’hui l’Arabie saoudite et l’Iran, se plaçant en troisième position des pays qui exécutent le plus.
C’est en réaction à une attaque lancée contre une école à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, que le gouvernement a décidé de reprendre les exécutions alors qu’il s’en était abstenu depuis 2008. Le moratoire avait initialement été levé pour les personnes inculpées d’infractions liées au terrorisme mais, en mars, le gouvernement a repris les exécutions pour tous les crimes emportant la peine capitale, tels que le meurtre ou le blasphème.
À la fin de l’année 2015, le Pakistan avait mis à mort 326 personnes, chiffre le plus élevé jamais recensé par Amnesty International. Dans un pays où le droit à un procès équitable est régulièrement bafoué et où des éléments extorqués sous la torture servent à condamner des gens, ils sont des centaines à se voir ôter la vie sous prétexte que justice soit rendue.
Des vies écourtées


Malgré tout, la tendance mondiale reste en faveur de l’abolition
La forte hausse des exécutions en 2015 a été contrebalancée par toute une série d’abolitions. Quatre États ont aboli la peine capitale pour tous les crimes : jamais depuis près de 10 ans autant de pays n’avaient aboli ce châtiment la même année.
Madagascar a été le premier pays à le faire en janvier, suivi par Fidji en février. En mars le Suriname, État sud-américain, a également supprimé la peine de mort de sa législation. Enfin, en novembre, le Congo a adopté une nouvelle Constitution faisant table rase de ce châtiment.
En décembre, la Mongolie a adopté un nouveau Code pénal abolissant la peine de mort pour tous les crimes. Ce texte entrera en vigueur en septembre 2016.
Même les États-Unis qui, cette année encore, ont bafoué le droit international en exécutant des personnes qui présentaient un handicap mental, ont continué de progresser vers l’abolition. La Pennsylvanie a aboli la peine capitale pour tous les crimes, portant à 18 le nombre d’États américains ayant aboli ce châtiment.
Il apparaît donc nettement que la tendance en faveur de l’abolition reste fortement marquée. Aujourd’hui, 102 pays (soit la moitié des pays du monde) ont définitivement tourné le dos à la peine capitale. Si l’on y ajoute ceux qui ont aboli ce châtiment dans la pratique, et non en droit, ce sont les deux tiers du globe qui n’y recourent plus.
Ceux qui continuent à exécuter sont minoritaires, confrontés à une vague d’opposition. Ils doivent faire un choix : conserver un système qui privilégie la sanction par rapport à la réadaptation, ou prendre le chemin de l’abolition, déjà largement emprunté, et se rallier au principe du droit à la vie de tout un chacun.

